Les poinçons Français (1789 à nos jours) de 1789 à 1798 : période dite « révolutionnaire »
Dans la nuit du 4 Août 1789, puis en 1791, par la loi Le Chapelier, les
«privilèges» et les corporations furent abolis, avec elles, disparurent
:
– le contrôle des métaux précieux
– les poinçons correspondants
– les taxes
La production d’argenterie devint anarchique et, en l’absence de contrôle, on trouve des pièces à un titre de 500/1000.
Mais alors qu’il n’existait plus de poinçons officiels, on a coutume de
décrire, sous le nom de «Poinçons Révolutionnaires», quatre poinçons
qui auraient été créés par «l’association des orfèvres » dans le but de
protéger la qualité de la fabrication.
Exemples de « Poinçons révolutionnaire »




Dans « Dictionnaire des Poinçons par Emile Beuque » au chapitre TETE DE
FEMME GRECQUE on peut lire :« Les droits de marque et de surveillance
du titre maintenus par un décret du 30 Mars 1791 survécurent aux impôts
indirects abolis par l’Assemblée Constituante et ne furent supprimés que
par l’Assembles Législative élue le 1 er octobre 1791. Libérées de tout
contrôle, les associations d’orfèvres qui avaient sollicité la
conservation de leur corporation, créèrent en 1793, ces poinçons pour la
garantie des titres des ouvrages en argent. Poinçons remplacés fin 1794
».
Cette interprétation est remise en cause dans le «Dictionnaire des
poinçons 1798/1838» (les cahiers de l’inventaire) où sous l’éminente
signature de Madame Arminjon, on peut lire : «les poinçons dits
« révolutionnaires » sont postérieurs à la période révolutionnaire car ils
sont contemporains de poinçons insculpés entre 1797 et 1838 et non
antérieurement. (il est proposé de les intituler » poinçons d’essai »)».
De 1798 à 1809 : période du « Premier Coq »
Les ouvrages sont insculpés de trois poinçons : (comme dans ces exemples)
le poinçon d’orfèvre ou fabriquant
Poinçon losangique de dimensions non déterminées par la loi, insculpé en position horizontale ou verticale. Il contient les initiales ou le nom du fabriquant et un différent



le poinçon de titre
Deux variantes :
- premier titre : coq ayant la tête tournée à gauche et un chiffre 1 placé devant les pattes
- deuxième titre : coq combattant, et le chiffre 2 placé derrière les pattes


le poinçon de garantie
une tête de vieillard de face
- dans un ovale pour la grosse garantie
- dans un cercle pour la moyenne garantie
- un faisceau de licteur pour la petite garantie
Les chiffres encadrant la tête identifient le département dans lequel l’objet a été contrôlé.



La date de fabrication des objets insculpés des poinçons du premier coq ne peut se situer qu’avec une incertitude de 10 ans « entre 1798 et 1809 ».
De 1809 à 1819 : période du « Deuxième Coq »
Les ouvrages sont insculpés de trois poinçons
le poinçon d’orfèvre ou fabriquant
Poinçon losangique de dimensions non déterminées par la loi Insculpé en position horizontale ou verticale Il contient les initiales ou le nom du fabriquant et un différent. On notera que ce sont les mêmes que pour le premier cop.



le poinçon de titre
Il représente encore un coq, mais afin de le distinguer du coq
précédent, on a créé quatre coqs, facilement distinguables du 1er parce
qu’ils sont entourés d’un sillon appelé » double listel » ( si le double
listel, permet une distinction immédiate entre premier et deuxième coq,
il n’est nullement spécifique de l’époque puisqu’on le retrouve a la
période « Vieillard »).
Les chiffres 1 et 2 indiquent le titre de l’ouvrage




le poinçon de garantie
– Moyenne et grosse garantie : quatre têtes de profil
– Petite garantie : un faisceau de licteur






La date de fabrication des objets insculpés des poinçons du deuxième coq ne peut se situer qu’avec une incertitude de 10 ans : « entre 1809 et 1819 »
De 1819 à 1838 : période du « Vieillard » ou « Michel-Ange »
Les ouvrages sont insculpés de trois poinçons :
le poinçon d’orfèvre ou fabriquant
Poinçon losangique de dimensions non déterminées par la loi Insculpé en position horizontale ou verticale Il contient les initiales ou le nom du fabriquant et un différent. On notera que ce sont les mêmes que pour les périodes précédentes depuis 1797.



le poinçon de titre




le poinçon de garantie



La date de fabrication des objets insculpés de ces poinçons ne peut donc, avec 20 ans d’incertitude, que « se situer entre 1819 et 1939 ».
De 1838 à 1973 : La Minerve
Quarante années furent nécessaires à la Garantie pour admettre que les poinçons de titre et de garantie faisant double emploi, on pouvait les rassembler en un seul, et en 1838 fut créé un poinçon unique, encore en usage de nos jours: la Minerve casquée.
le poinçon d’orfèvre ou fabriquant
Poinçon losangique de dimensions non déterminées par la loi Insculpé en position horizontale ou verticale Il contient les initiales ou le nom du fabriquant et un différent. On notera que ce sont les mêmes que pour les périodes précédentes depuis 1797.



Un poinçon unique pour le titre et la garantie des gros et moyens ouvrages
Le titre : reste fixé à 950 millièmes pour le premier titre et 800 millièmes pour le second.
Le poinçon de titre et de garantie pour les gros et moyens ouvrages sont :
- 1er titre: tête de minerve dans un octogone ; le chiffre 1 placé devant le front confirme le premier titre
- 2ème titre: tête de minerve dans un ovale tronqué le chiffre 2 placé sous le menton, confirme le deuxième titre


Le poinçon de titre pour les petits ouvrages
Ces poinçons certifient que le titre de la pièce insculpée est au moins, au minimum légal de 800 millièmes.
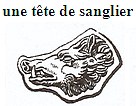
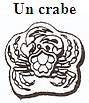
A moins de se référer à la biographie de l’orfèvre, la date de fabrication d’une pièce de cette période, ne peut donc que « se situer » entre 1838 et 1973, soit une incertitude de 135 ans.
De 1973 à nos jours: La Minerve datée
Deux changements importants:


Le premier titre est enfin abaissé : il passe de 950 millièmes à 925 millième. Le chiffre 1, indicatif du titre, est placé en arrière du cou
Une lettre date , changeant tous les 10 ans, est placée devant le cou
- A pour 1973-1982
- B pour 1983 -1992
- C pour 1993- 2002
- D pour 2003- 2012 etc
Le deuxième titre étant maintenu à 800 millièmes, la Minerve reste comme elle était en 1838. Les ouvrages au deuxième titre ne sont donc toujours pas datables.
Autres poinçons d’argent
En plus des poinçons que nous venons de décrire, pour des raisons administratives, il en existe……des dizaines et des dizaines: poinçons d’exportation, de retour, de hasard, mixtes, etc… Les décrire tous, aboutirait à un dictionnaire de poinçon alors que notre but est d’apporter à un amateur les notions élémentaires lui permettant d’ identifier la plupart des pièce d’orfèvrerie française. Nous nous limiterons donc à la description de deux poinçons trouvés fréquemment sur les pièces provenant de salles de ventes:
Le Cygne
Il est insculpé sur les ouvrages provenant des ventes publiques, dont on ne peut pas déterminer la provenance mais titrant, au moins, le minimum légal de 800 millièmes

Le charançon
Il s’applique à tous les ouvrages importés titrant, au moins, le minimum légal de 800 millièmes
